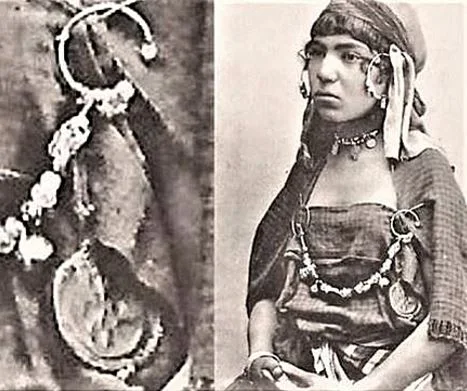Mise à jour en date de 2025.07.28 : adjonction des figures A et B relatives à des Khors de même type à plusieurs chainettes dont l'un garde son pendentif à crochet.
Fig.A - Patrimoine de Tunisie – Bijoux ethniques en argent – Khors à chainettes avec pendentif à crochet, pendeloques et monnaies – Période beylicale du 18è et 19è siècles – Réf. ARTmedina-tounes. Fig.01 - Patrimoine de Tunisie – Bijoux ethniques en argent – Khors à chainettes avec amulette cylindrique, pendeloques et monnaies – Période beylicale du 18è et 19è siècles – Réf. ARTmedina-tounes.
Fig.01 - Patrimoine
de Tunisie – Bijoux ethniques en argent – Khors à 8 chainettes avec pendeloques
et monnaies – Période beylicale du 18è et 19è siècles – Réf. ARTmedina-tounes.
Le Khors est vraisemblablement
une terminologie Berbéro Loubique* pour
désigner une boucle à chainettes, un bijou faisant partie d’une vaste panoplie
de bijoux pour parer l’habit de la Melia de la berbéro bédouine de Tunisie. Il
est utilisé en tant qu’anneau d’oreille suspendu à une chaine au-dessus de la
tête (ou accroché à un pendentif à crochet-épingle qui vient s'accrocher directement au tissu de la Melia) et venant se balancer au niveau de l’oreille. De diamètre aux environs de
10 cm, Monhel, dans son cahier artistique n°04 intitulé : « Bijoux
berbères de Tunisie » (1), en dénombre plusieurs modèles berbéro-bédouins avec
photos et leur consacre tout un chapitre.
*Les Loubiques, ancêtres des berbères, sont les contemporains des
pharaons et premiers habitants de l’Afrique du nord. Les tribus Loubiques (des
Gamarantes jusqu’aux Numides) se sont confrontés aux Puniques carthaginois,
puis aux romains, qu’ils considéraient comme colonisateurs de leur territoire.(Pour désigner les ancêtres des berbères, le terme Loubique est plus approprié que Libyque).
Le Khors en figure 01 est
assez original par sa conception et par le nombre impressionnant de chainettes
et pendeloques qu’il comporte. Ses diverses pendeloques spécifiques ;
rares modèles (œuvres d’art) décrits ci-après ; s’éloignent des
pendeloques de mains et ronds caractéristiques des bijoux en argent de la
berbéro bédouine de Tunisie. La plupart des monnaies est d’origine espagnole du
17è et 18è siècles. Les chainettes sont de type n°04 (1) classées par Monhel
parmi les 4 chaines utilisées pour la conception des bijoux berbéro bédouins de
Tunisie.
Avec ces trois indications,
pendeloques, monnaies et chainette de type 4**, on peut dire que ce bijou Khors de Tunisie
fait partie des bijoux élaborés par l’ethnie tunisienne composée des immigrés juifs ayant fui l’inquisition catholique d’Espagne/Portugal notamment du
17è siècle et qui ont pu s'intégrer à côté des ethnies locales nomades, berbéro -bédouines et sédentaires des villes. chaque ethnie veillant à ses propres traditions religieuses et coutumes ancestrales dans le respect mutuel.
**La chainette classée par Monhel de type 4, chaine classique élaborée par l'assemblage de petits anneaux ronds les uns aux autre sans soudage, n'entre pas dans le processus d'élaboration des chaines (types 1, 2 et 3) employées pour la fabrication des bijoux berbéro bédouins de Tunisie (1). Ces dernières chaines sont élaborées avec le principe de soudure de l'ensemble des anneaux les uns aux autres.
Des immigrés juifs et mauresques accueillis chaleureusement et à bras ouverts par des Deys et Beys
clairvoyants*** pour acquérir leur savoir-faire
technique qui a contribué au grand essor économique de
la régence de Tunis des siècles durant. Le développement des techniques
innovantes a touché l’ensemble des secteurs économiques de la régence, de
l’agriculture à l’artisanat en passant par le cuir et textile.
*** Othman Dey 1594 – 1610 ; Youssef Dey 1610 – 1637 ;
Mourad 1er Bey (1613- 1631) et son fils Hammouda Pacha Bey (1631-
1666).
Fig.02 - Patrimoine
de Tunisie – Bijoux ethniques en argent – Khors à 8 chainettes de conception
originale ne faisant pas appel à la soudure – Période beylicale du 18è et 19è siècles
– Réf. ARTmedina-tounes.
L’exemple du présent Khors
nous révèle une technique de fabrication ne faisant pas appel à la soudure. Une
technique qui remonte bien avant l’antiquité, employée notamment par l’Egypte
des pharaons, les grecs (Boucles en figure 03) , les romains et autres byzantins. Reprise par
les artisans immigrés juifs dès le 17è pour enrichir la panoplie de bijoux en
argent de l'habit de la Melia de la berbéro bédouine et des différentes ethnies, musulmanes, juives et chrétiennes,
cohabitant en harmonie dans la régence beylicale.
Fig. 03 – Bijoux
en or de l’antiquité – Boucles d’oreilles – Musée d’Athènes – Réf. Web sur X.
La conception du Khors en figure 01 est assez ingénieuse à partir de simples composants : fils ronds de
différents diamètres (2 et 0.8 mm), chainettes, boules et divers pendeloques
dont des monnaies en argent de l’époque de l’inquisition catholique du 17è et
18è siècles que les immigrés juifs ont vraisemblablement ramené avec eux d’Espagne :
Une monnaie de Léopold d’Autriche
frappée en 1629 :
Fig.04 - Bijoux
ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes avec
pendeloques – Pendeloque/Monnaie en argent de Léopold d’Autriche frappée en 1629 –
Réf. ARTmedina-tounes 8AB.
Quatre monnaies en argent
d’Espagne frappées sous les Philippes :
Fig.05 - Bijoux
ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes avec
pendeloques – Pendeloque/Monnaie en argent d’Espagne frappée en …sous Philippe …–
Réf. ARTmedina-tounes 9AB.
Fig.06 - Bijoux
ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes avec
pendeloques – Pendeloque/Monnaie en argent d’Espagne frappée en (..)26 sous
Philippe …– Réf. ARTmedina-tounes 12AB.
Fig.07 - Bijoux
ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes avec
pendeloques – Pendeloque/Monnaie en argent d’Espagne frappée en …sous Philippe …–
Réf. ARTmedina-tounes 16AB.
Fig.08 - Bijoux
ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes avec
pendeloques – Pendeloque/Monnaie en argent (famille des Ryales) d’Espagne frappée en 1721 sous Philippe
5 (1700-1746) – Réf. ARTmedina-tounes 21AB.
Le reste des monnaies sont deux
beylicales tunisiennes sous les ottomans et une beylicale sous les français.
La première sous le sultan
Mahmoud 1 (1730-1754) (nom lisible) :
Fig.09 - Bijoux
ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes avec
pendeloques – Pendeloque/Monnaie en argent de la régence de Tunis frappée sous le
sultan ottoman Mahmoud 1 (1730-1754) – Réf. ARTmedina-tounes 18A.
La deuxième n’indique pas
lisiblement le nom du sultan alors que la date est indiquée par trois chiffres
114…AH. Elle est frappée soit sous Ahmed 3 (1703-1730) si la date limite lue
est 1140 AH (1728 AD), soit sous Mahmoud 1 (1730-1754) si la date limite lue
est 1149 AH (1737 AD) :
Fig.10 - Bijoux
ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes avec
pendeloques – Pendeloque/Monnaie en argent frappée à Tunis (lisible sur
le revers). Elle n’indique pas
lisiblement le nom du sultan alors que la date est indiquée au revers par trois
chiffres 114…AH (le prolongement de la
lettre arabe « Fi » peut induire en erreur en le considérant comme un
chiffre 1 supplémentaire pour lire la date de 1114 AH). Elle est frappée
soit sous Ahmed 3 (1703-1730) si la date limite lue est 1140 AH (1728 AD), soit
sous Mahmoud 1 (1730-1754) si la date limite lue est 1149 AH (1737 AD) –
Réf. ARTmedina-tounes 32AB.
La 8ème et
dernière monnaie est la plus récente. Une monnaie d’Ali 3 Bey (1882-1902)
frappée sous le Protectorat français en 1891, l’année de mise en place dans la
régence de Tunis du nouveau système monétaire français du Franc et du centime,
avec écartement définitif du système monétaire du Ryal tunisien (équivalent à
la Piastre espagnole).
Fig.11 - Bijoux
ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes avec
pendeloques – Pendeloque/Monnaie de 50 centimes en argent du Bey Ali 3 (1882-1902)
frappée à Tunis en 1891 sous le Protectorat français– Réf. ARTmedina-tounes
25AB.
Quant au reste des pendeloques,
au nombre de cinq, ce sont des modèles assez originaux, de rares œuvres d’Art :
Fig.12 - Bijoux
ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes -
Pendeloque en argent – Réf. ARTmedina-tounes 01AB.
Fig.13 - Bijoux
ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes -
Pendeloque en argent – Réf. ARTmedina-tounes 02AB.
Fig.14 - Bijoux
ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes -
Pendeloque en argent – Réf. ARTmedina-tounes 03AB.
Fig.15 - Bijoux
ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes -
Pendeloque en argent – Réf. ARTmedina-tounes 04AB.
Fig.16 - Bijoux
ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes -
Pendeloque en main d’ivoire (ou os) – Réf. ARTmedina-tounes 05AB.
(1(1) Cahier
artistique n°04 ARTmedina-tounes intitulé : « Bijoux berbères en
argent de Tunisie », Monhel, 2023, Amazon (https://www.amazon.fr/Bijoux-berb%C3%A8res-en-argent-Tunisie/dp/B0BSWY5XH1/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.bJBVHX0QM7vbg940Q
)
ARTmedina-tounes
Musée virtuel Helioui Ahmed
de l’argenterie et des arts
Copyright